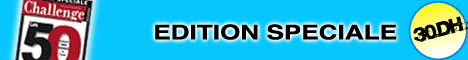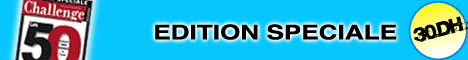| Adoption, kafala ou recueil
légal : Mode d’emploi d’un calvaire à vivre pour le sourire
d’un enfant
Sanaa Laqzadri
01 Avril 2002
|
|
D’une rive, ils sont plusieurs à
guetter le sourire d’un enfant. Ils sont plusieurs à désirer
l’adopter, l’élever et le chérir en enfant légitime. De l’autre
rive, ils sont aussi plusieurs à attendre père et mère. Ils sont
plusieurs à invoquer le tendre regard d’un parent adoptif.
Sept années de mariage se sont écoulées sans que le cri d’un
enfant ne brise le silence du foyer, sans que sa joie n’illumine la
vie de ce couple de ressortissants marocains en France. Pourtant
l’espoir n’était plus au rendez-vous: l’homme était “stérile” et la
femme est devenue une terre asséchée. A eux deux, ils couvaient tout
l’instinct maternel et paternel qui ne devait jamais être comblé.
Au cours d’un voyage au Maroc, alors que leur espoir d’adopter
un enfant marocain via le MAI (Mission de l’adoption internationale)
s’estompait, Salma l’épouse rencontre une mère célibataire, enceinte
de sept mois et qui ne désirait ni la grossesse, ni le bébé témoin.
La famille de Salma accueillit dès lors la mère, la prit en
charge et assura un accouchement sans complications. Entre temps, le
couple (Ahmed et Salma), prolonge son séjour au Maroc en attendant
l’arrivée du bébé, qui sera désormais et selon la loi leur fils
unique et légitime.
Frauduleuse action! Nous ne pourrons en
juger. Ce couple qui témoigne un fervent désir d’adopter un enfant
abandonné marocain, de subvenir à ses besoins, d’assurer son
éducation, de l’aimer, de le chérir, s’est constamment heurté aux
rouages de l’administration. Rendant ainsi la procédure d’adoption
lente , pénible voire intolérable.
Ayant l’agrément du service
de l’Aide Socialeà l’Enfance de leur département (qui procède à une
enquête sociale et à des investigations psychologiques), le couple
se renseigna auprès de la MAI et prépara un dossier complet et
légalisé, adressé à une institution du pays.
S’arrêtant à la
5ème phase de la procédure d’adoption, qui en compte 8, le couple a
retrouvé “le bonheur en hébergeant, en soutenant et en dédomageant
une mère naturelle qui comptait léguer sa progéniture aux vents du
hasard”, renchérit Salma.
Adopter un enfant marocain, les
embûches juridiques internationales
Ce choix s’explique par
la lente et difficile procédure et par les délicats problèmes que
soulèvent l’adoption d’un enfant étranger par des MRE ou par des
Français en France, à titre d’exemple : la sortie de l’enfant de son
pays d’origine doit être conforme au pays de son entrée à savoir la
France, et doit être par conséquent conforme au droit français.
Trois voies se présentent aux futurs adoptants. La première
consiste à engager à l’étranger une instance directe visant le
prononcé de l’adoption et à demander par la suite sa reconnaissance
en France, mais cette voie n’a pas la faveur de la pratique. La
seconde consiste à engager directement en France une instance
directe visant le prononcé de l’adoption. Quant à la troisième, elle
cumule deux instances directes : les adoptants obtiennent d’abord,
dans le pays d’origine de l’enfant, une décision prononçant
l’adoption et engagent ensuite sur la base de cette décision, une
deuxième action devant les tribunaux français ayant pour but le
prononcé de l’adoption.
Par ailleurs, le développement d’une
jurisprudence française récente relative à l’adoption en France
d’enfants marocains montre qu’elle pose des problèmes juridiques
spécifiques, puisque l’articulation du droit marocain, et
conformément au droit musulman, interdit de manière expresse et non
équivoque la filiation adoptive.
En effet l’article 83, alinéa 3
du dahir marocain du 18 décembre 1957 dispose que “l’adoption n’a
aucune valeur juridique et n’entraîne aucun des efffets de la
filiation”. L’adoption est donc prohibée et seul existe le “Recueil
légal”, défini par le dahir marocain du 10 septembre 1993 et qui
stipule: “La personne assurant la kafala ou l’institution concernée
veille à l’exécution des obligations relatives à la protection de
l’enfant abandonné et doit assurer son éducation dans une ambiance
familiale saine, tout en subvenant à ses besoins essentiels jusqu’à
ce qu’il atteigne l’âge de la majorité”.
Or, l’étude de la
jurisprudence française, qui concerne essentiellement l’adoption en
France d’enfants marocains, montre que malgré une certaine
résistance des juges du fond, la Cour de cassation admet que le juge
puisse s’affranchir des limites de la loi nationale pour apprécier
le consentement même.
En effet, montrant un respect scrupuleux
de la loi nationale de l’adopté et considérant que le consentement
ne pouvait s’en détacher, certaines décisions des juges du fond ont
refusé de prononcer l’adoptin simple d’enfants marocains.
C’est
ce qui ressort d’un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la Cour d’appel
de Paris. En l’espèce, un ressortissant français domicilié au Maroc
accueille à son domicile un enfant âgé de 6 ans. En 1988, les
parents marocains de l’enfant consentent à sa kafala par le
ressortissant français. En 1989, ils consentent, devant l’officier
d’état civil de Sidi Slimane, à son adoption simple. L’adoptant
saisit le Tribunal de grande instance de Paris, d’une requête aux
fins d’adoption simple de l’enfant. Mais le juge parisien rejette sa
demande au motif que la loi nationale de l’adopté ignore l’adoption.
Le jugement est confirmé par la Cour d’appel de Paris selon laquelle
“ en matière d’adoption internationale, les conditions du
consentement et de la représentation de l’adopté sont régies par la
loi personnelle de l’adopté”.
Aussi, la position des juges du
fond semble cependant critiquable, renchérit Souhayma Ben Achour,
assistante en droit privé, qui l’explicite dans son travail sur
l’Adoption d’enfants magrhébins en France: “même si la kafala et
l’adoption simple produisent des effets différents, le principe
reste qu’aucune substitution de filiations n’a lieu dans les deux
cas”.
Enfants vendus, paternités achetées
Mais si la
procédure d’adoption d’un enfant marocain par des (MRE) ou par des
étrangers s’avère difficile et décourageante, elle sauvegarde le
même aspect au Maroc. Encourageant ainsi fraudes et transgressions
de la loi.
Un nouveau marché se met implicitement en place,
celui de la vente des nouveau-nés. Des mères célibataires en
détresse trouvent des familles “bienveillantes” qui les dédommagent
et qui adoptent leurs enfants. Le prix du bébé varie de 1000 à
25.000 DH.
La floraison de ce marché émane essentiellement de la
loi restrictive qui relègue l’adoption à une simple prise en charge
“kafala”. La kafala ne crée aucun lien de parenté entre le kafil et
le makfoul. Le statut de makfoul ne se rapproche de celui de
l’enfant légitime que sur deux points : la tutelle, conférée au
kafil et l’obligation alimentaire qui est à sa charge. Aussi, la
kafala n’entraîne aucun empêchement à mariage entre le makfoul d’une
part, le kafil et sa famille d’autre part. Le makfoul ne prend pas
le nom du kafil et porte le nom qui lui est conféré par l’état
civil, possédant dès lors un livret de famille particulier.
D’où
le recours au contact direct de la mère naturelle, qui assure la
filiation sans sombrer dans les rouages administratifs.
Un
procédé dont témoigne Karima, mère célibataire prise en charge par
son employée qui désirait élever un enfant : “elle savait que
j’étais enceinte et que je ne pouvais revenir chez mes parents. Je
lui ai tout raconté et elle a accepté avec l’accord de son mari de
me garder à la maison jusqu’à la fin de ma grossesse. J’ai enfanté
chez elle avec l’aide d’une sage femme. et elle a pris soin de moi,
mais je ne pouvais voir ma fille, ni l’allaiter... D’ailleurs, je
crois que c’est pour notre bien à tous. Ma fille porte le nom de la
famille et vivra certainement aisément, quant à moi, j’ai dû quitter
mon travail, moyennant une somme d’argent que mes employés m’ont
offerte”
Un autre procédé d’adoption, par voie légale, consiste
à présenter une requête au juge d’instruction de première instance,
ainsi qu’une copie de la CIN des parents adoptants et des tuteurs de
l’enfant, le certificat de résidence des adoptants et l’enquête de
la police. Après le verdict positif du juge d’instruction, l’enfant
peut intégrer la famille adoptive.
“Ce procédé simplifié, nous
explique Maître Fatiha Hssein avocate au barreau, permet à la
famille adoptive et à l’enfant d’écourter le “supplice”, sans
oublier qu’on doit avant tout préserver l’intérêt de l’enfant. Son
intérêt serait de vivre dans un milieu sain où ses différents
besoins matériels sont assurés, où éducation et enseignement lui
seront inculqués. Aussi, le juge d’instruction prend en
considération ces éléments sans oublier que le tuteur, en acceptant
l’adoption, se dégage de ses responsabilités”.
Le recueil légal,
une épreuve à vivre
Nouveau-nés emmitouflés dans des
journaux, jetés dans les impasses, posés au seuil des portes, livrés
aux griffures et aux morsures de chats et de chiens. Ils étaient
abandonnés dès leur naissance au froid, à la faim, aux patrouilles
de police, à la mort.Orphelins, ou abandonnés par des parents sans
ressources, ou encore enfants de parents “drogués” incapables de les
élever, ils sont nombreux à être jugés “enfants abandonnés” par le
tribunal de première instance après trois mois de leur existence
dans les orphelinats et les institutions publiques.
Leur nombre
croît crescendo et comble les salles des orphelinats et des
institutions publiques. Pourtant, nombreuses sont les demandes
d’adoption adressées à ces institutions. Nous ne saurons ni leur
nombre, ni le traitement réservé aux enfants et aux familles,
puisque vaines étaient nos tentatives d’approcher une institution
modèle comme l’institution Lalla Hasna.
Par ailleurs, si la
directrice a refusé de nous renseigner pour des raisons qui lui sont
personnelles, Bouchaib El Mejdoub, inspecteur à l’état civil de la
wilaya de Casablanca, nous a explicité la procédure du “recueil
légal” : “ les familles désirant adopter un enfant jugé abandonné,
adressent une demande au wali ou à l’institution reconnue par le
statut d’utilité publique. Par ailleurs, le dahir du 10 septembre
1993, relatif aux enfants abandonnés, a délimité les critères des
parents adoptants au couple de musulmans, mariés depuis au moins 3
ans.”
En effet, le couple doit remplir les conditions suivantes
:
être adulte, apte moralement et socialement, en disposant des
moyens matériels nécessaires pour la prise en charge d’un enfant.
Ne pas avoir été condamné dans une affaire de moeurs ou pour un
crime contre des enfants
Etre sain de toute maladie contagieuse
ou ne lui permettant pas d’exercer sa responsabilité.
Les
parents adoptants, qui remplissent ces conditions, adressent une
demande légalisée au wali ou directement à l’institution. Ces
derniers demandent aux autorités locales de procéder à une enquête
sociale et à une autre administrative.
La constitution du
dossier de la demande d’adoption consiste à présenter différents
documents
Attestant l’aptitude morale et financière des parents
à savoir : fiches anthropométriques du couple, copies des CIN,
attestations de salaire et titres de propriété, certificat de
résidence, copie de l’acte de mariage, certificats médicaux.
Après présentation du dossier, une assistante sociale rend
visite au domicile des parents et rédige son rapport en notant
l’aisance des parents, l’intensité de leur désir d’adoption,
l’harmonie familiale, l’âge de la mère... L’examen jugé positif du
dossier permettra au wali ou à l’institution d’accorder “le Recueil
légal” aux parents.
Notons que le texte du dahir du 10 septembre
1993 confère à une commission administrative la responsabilité de
remettre l’enfant à ses parents adoptants. Or, cette commission n’a
jamais été constituée selon les dires de B. Elmejdoub, inspecteur à
l’état civil de la wilaya de Casablanca.
Quant au suivi de la
post-adoption, il relève de l’idéal, puisqu’il nécessite selon B.
Elmejdoub “des moyens financiers considérables et dont ne disposent
généralement pas les institutions publiques”. Autrement dit, le
suivi sur le terrain est pratiquement inexistant.
Ce qui nuit
surtout à l’enfant adopté, c’est qu’il peut être victime de
maltraitance, d’abus sexuel... sans que l’institution ne remédie à
la situation. A l’instar des filles adoptées, reléguées au statut de
“bonnes”, et qu’on ne peut traduire en chiffres, puisque le suivi
manque.
En outre, le pouvoir des institutions publiques reste
restreint. Il est limité par les textes de loi qui stipulent qu’un
enfant makfoul “maltraité” est toujours sous la tutelle légale du
kafil et l’on ne peut retirer la garde de l’enfant, ou annuler le
“recueil légal” sans porter l’affaire devant le tribunal de première
instance qui jugera de l’état de l’enfant et des parents adoptants.
La règle basique de “ ce qui est donné par la loi, ne peut être
pris que par la loi” ne protège pas les enfants adoptés et
maltraités.
Plaidons le projet de la loi d’adoption
Tout en
restant fidèle aux préceptes de l’ancienne loi de 1993, le projet de
la loi d’adoption, en instance d’étude atuellement au parlement,
propose de nouvelles clauses qui simplifient la procédure tout en
sauvegardant l’intérêt de l’enfant.
Notons une nouvelle
condition de l’article 7, caractérisant les parents adoptants qui ne
doivent avoir ni avec l’enfant concerné, ni avec ses parents s’ils
existent, aucun conflit judiciaire ou familial pouvant porter
atteinte à la prise en charge.
Ces conditions ne s’appliqueront
plus seulement au couple, mais notamment à toute femme musulmane,
sans définir pour autant son statut (célibataire, veuve, divorcée)
L’article 12 stipule que la prise en charge d’un enfant âgé de
plus de 12 ans accomplis, ne peut avoir lieu qu’avec son accord
personnel. Quant à l’article 17, il permet au juge, une fois
vérifiée la conformité du preneur en charge aux 4 conditions,
d’accorder la tutelle à la personne avec application immédiate de
cette décision.
Un apport considérable de l’article 20 prévoit
en effet “qu’une demande de changement de nom peut être faite au
bénéfice d’un enfant mineur, né de père inconnu par la personne
l’ayant recueilli légalement dans le cadre de la kafala en vue de
faire coordonner le nom patronymique de l’enfant recueilli avec
celui de son tuteur” à l’instar du décret exécutif algérien en date
du 13 janvier 1992.
Ce projet de loi est en cours d’étude
actuellement et pourra certainement alléger la procédure d’adoption
en rendant la kafala effective dans les 15 jours qui suivent la
décision. Encourageant ainsi le “recueil légal” des enfants
abandonnés, qui sont les premiers concernés et qui, de par leur
innocence ont le droit à une vie digne, à la vie de famille.
|